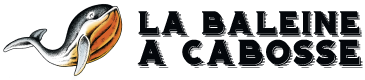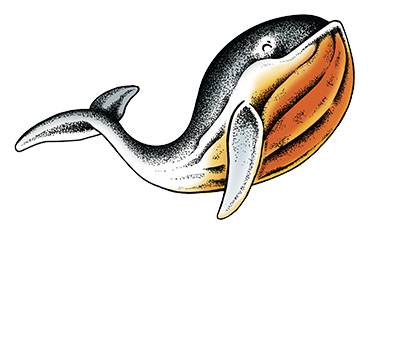Le cacaoyer : au cœur d’un arbre peu ordinaire
Le cacaoyer, arbre tropical cultivé depuis des millénaires, fascine depuis la nuit des temps. Domestiqué il y a plus de 5 000 ans en haute Amazonie, il fut considéré comme un arbre divin par la civilisation maya. Sans surprise, son nom scientifique s’inspire de son passé précolombien sacré : theobroma cacao, signifiant en latin « nourriture des dieux ». Dans cet article, on vous dévoile tous les secrets du cacaoyer, cet arbre hors du commun.
Le cacaoyer : l’origine de l’arbre
Si les premières traces de culture du cacaoyer datent d’il y a plus de 5 000 ans en haute Amazonie (1), son origine en tant qu’espèce botanique remonterait à près de 10 millions d’années.
Il a besoin d’un climat chaud et humide pour pleinement s’épanouir. Craintif de la lumière directe, il préfère s’entourer d’autres arbres plus hauts, dont les feuillages créent l’ombre dont il a besoin. Il profite ainsi d’un peu de soleil, mais pas trop ! Le cacaoyer mesure en général entre 5 et 10 mètres, même s’il peut parfois atteindre 15 mètres s’il n’est pas taillé. Eh oui, comparé aux autres géants de la forêt tropicale, le cacaoyer est plutôt d’un petit gabarit !
Pendant des millénaires, il a poussé en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avant d’être introduit dans d’autres régions du monde, notamment en Afrique et en Asie.
La pollinisation
Pendant la floraison, le cacaoyer se pare de milliers de petites fleurs, regroupées en bouquets qui poussent directement sur le tronc et les branches. C’est ce qu’on appelle un arbre cauliflore.
Ses fleurs sont, paradoxalement, sans odeur et sans sucre, contrairement au chocolat qui sera sucré et parfumé. Quant à la pollinisation, elle est très difficile, car peu d’insectes peuvent atteindre les coins et recoins de ces minuscules fleurs. D’ailleurs, les chercheurs n’ont toujours pas identifié avec certitude les véritables pollinisateurs du cacaoyer. C’est pourquoi, sur une centaine de milliers de fleurs présentes sur l’arbre, seulement 1% donneront naissance à des cabosses.
Sous la canopée, le cacaoyer est connu pour être un arbre très infidèle ! Ses fleurs, qui possèdent à la fois des organes mâles et femelles, contiennent de nombreux pistils aux caractéristiques génétiques différentes. En effet, lorsqu’une fleur est pollinisée par plusieurs cacaoyers voisins, il n’est pas rare de trouver, dans une même cabosse, des fèves aux goûts et aux couleurs différents ! On les appelle alors des demi-sœurs.

Le cacaoyer en floraison
(crédits photo : Perry Stevens)
La cabosse de cacao
Vous l’aurez deviné : le fruit d’un cacaoyer s’appelle la cabosse. L’origine de ce mot vient de l’espagnol « la cabeza », qui signifie « la tête ». Et quand on dit qu’un objet est cabossé, c’est qu’il est déformé par des creux ou des bosses : on n’est pas loin de l’aspect du fruit dont on parle !
Car oui, la cabosse est un fruit qui ne passe pas inaperçu ! Avec son aspect de ballon de rugby (un peu cabossé 🙂), elle fait partie des plus gros fruits du monde : elle peut mesurer de 10 à 30 cm de long et peser jusqu’à 1 kg. Elle met entre 4 et 6 mois à arriver à maturité.
À l’intérieur, on trouve les fameuses fèves de cacao, entourées d’une pulpe blanche, appelée mucilage, qui est parfaitement comestible, et même agréable à déguster ! En la pressant, on obtient du jus de cacao, naturellement sucré, aux notes légèrement acidulées. Un vrai délice pour se désaltérer !
Selon les variétés, une cabosse contient entre 20 et 60 fèves. Juste ce qu’il faut pour fabriquer une tablette de chocolat !
La récolte
Au moment de la récolte, le tronc et les branches du cacaoyer sont parsemés de cabosses mûres. En fonction des variétés, elles prennent des teintes jaunes, orangées ou rouge vif.
Si personne ne les cueille à temps (ni producteur, ni animal gourmand), elles finissent par pourrir sur l’arbre. En général, la récolte a lieu deux fois par an, même si dans certaines régions proches de l’équateur, elle peut se faire presque toute l’année.
Et concrètement, comment ça se passe ?
Les cabosses mûres sont cueillies à la main, une par une, puis rassemblées au pied des arbres. C’est là que commence l’écabossage. Équipés d’une machette, les cueilleurs ouvrent les fruits pour en extraire les fèves encore enveloppées de leur pulpe blanche (le fameux mucilage).
Un premier tri est effectué sur place, puis les fèves fraîches sont rapidement transportées vers un centre de post-récolte pour entamer l’étape cruciale de la fermentation. À pied, à moto, à dos d’âne ou en voiture… tous les moyens sont bons pour aller vite et garantir leur fraîcheur !
Mais avant de se transformer en tablette de chocolat, les fèves de cacao doivent passer par de nombreuses étapes de maturation et de transformation. Si le sujet vous intrigue, nous avons détaillé toutes les étapes de fabrication du chocolat dans un article dédié.
Les variétés génétiques du cacaoyer
Vous avez probablement entendu parler des trois grandes variétés de cacao, qui sont à l’origine de tous les cacaos du monde : le Criollo, le Forastero et le Nacional.
Le Criollo est probablement la première variété de cacao cultivée par l’homme, et concrètement par des Olmèques il y a 2 500 à 3 000 ans, qui l’auraient découvert au nord de l’Amérique du Sud, avant de l’introduire et de le cultiver au Mexique. C’est aussi la variété découverte par les Espagnols au XVIe siècle sur les côtes mexicaines. Les cabosses mûres du Criollo sont d’une couleur rougeâtre et enferment des fèves blanches bien dodues. Dans le monde du cacao d’exception, elle est connue pour ses notes fines et fruitées, mais reste fragile à cultiver.
Quant à la variété Forastero, elle a été aperçue pour la première fois par des colons espagnols au fin fond de la forêt amazonienne, dans l’actuel Venezuela. Les cabosses, jaunes et lisses, bien différentes des cabosses rouges connues jusqu’à présent, furent nommées Forastero, signifiant « non-Criollo » : étranger à la variété connue. Les fèves du Forastero sont violettes et plates. Cette variété a été introduite au Brésil au XVIIIᵉ siècle et est aujourd’hui cultivée en Afrique pour son haut rendement.
Et enfin, la variété Nacional a été découverte dans les forêts denses au pied de la cordillère des Andes, dans l’actuel Équateur. Ses cabosses ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles du Forastero, avec des fèves également violettes, mais plus charnues. Toutefois, la différence se joue notamment dans l’arôme absolument envoûtant du Nacional, aux notes de fleurs, jasmin et fleur d’oranger (2). Grâce au Nacional, l’Équateur est entré dans un club très restreint des pays cultivant un cacao haut de gamme, prisé par les chocolatiers du monde entier. Cette variété a pourtant failli disparaître en 1916, lors d’une épidémie du « balai de sorcière » qui a ravagé les plantations équatoriennes. Heureusement, une partie infime a pu être sauvée !
Mais cette classification, bien que pratique, est bien trop simpliste et ne reflète pas la diversité génétique des cacaoyers. Elle se base uniquement sur l’aspect des cabosses, des fèves et des feuilles, ce qui est un peu réducteur. C’est pourquoi, en 2008, un article scientifique (3) d’un groupe de chercheurs a bouleversé le monde du cacao. Il a mis au point une nouvelle classification, basée non plus sur l’apparence des cacaos, mais sur leur ADN. Ainsi, elle recense 10 variétés génétiques du cacao, nommées selon leurs origines géographiques :
- Amelonado
- Contamana
- Criollo
- Curaray
- Guiana
- Iquitos
- Marañón
- Nacional
- Nanay
- Purús
Vous remarquerez que le Criollo ainsi que le Nacional sont bel et bien conservés. En revanche, le Forastero, génétiquement trop hétérogène, a disparu de la classification.
Il est important de préciser qu’il s’agit ici des 10 grandes familles génétiques du cacaoyer, chacune regroupant des variétés plus spécifiques. Mais même dans ces cas, il est rare de produire un cacao issu d’une seule variété, à 100% pure. Pourquoi ? Parce que le cacaoyer se pollinise de manière croisée.
Souvenez-vous : une fleur de cacaoyer peut être fécondée par du pollen provenant de plusieurs cacaoyers voisins, appartenant à d’autres variétés. La cabosse qui en résulte porte alors en elle un mélange de patrimoines génétiques. Cette hybridation naturelle est impossible à contrôler totalement.
Mais il existe des exceptions rares. Dans le canyon du Marañón, au Pérou, un cacaoyer baptisé « Fortunato n°4 » a été identifié comme 100 % pure Nacional — un cas exceptionnel. On s’approche ici d’une pureté génétique remarquable, estimée entre 95 et 99% pour la variété Nacional-Marañón. Depuis cette découverte, les producteurs veillent à ne pas introduire d’autres variétés sur les parcelles, afin d’éviter la pollinisation croisée et préserver cette rareté génétique. Vous pouvez goûter le fruit de ce travail avec notre tablette Pérou Marañón 72%, fabriquée à partir de fèves issues exclusivement de cette variété pure.
Pour illustrer la richesse génétique des cacaos, prenons l’exemple de la variété Amelonado. On retrouve son empreinte dans plusieurs de nos chocolats : elle est présente dans les fèves utilisées pour notre tablette São Tomé 70%, mais aussi dans celles de la tablette Mexique Tabasqueño 65%, issues d’un mélange de Criollo, Trinitario et Amelonado.
Dans le mouvement bean-to-bar, on tend à cultiver les cacaoyers en petites plantations, favorisant l’hybridation naturelle avec une sélection de variétés ciblées, un peu comme des parcelles monocépages, si l’on veut faire un parallèle avec le monde du vin. Vous voyez : en matière de variétés et de terroirs, le chocolat n’a vraiment rien à envier au vin ! 🙂
À l’inverse, dans le cacao industriel, les variétés sont volontairement croisées pour créer des hybrides à haut rendement et plus résistants aux maladies. Aujourd’hui, la création de ces variétés hybrides, bien plus rentables, fait peu à peu disparaître de nombreuses variétés de cacao en Amérique centrale et du Sud. Heureusement, des populations indigènes comme les Machiguenga ou les Arhuacos, se battent au quotidien pour préserver les variétés ancestrales de cacao, cultivées depuis des millénaires.
Pour découvrir l’origine des variétés du cacao, ainsi que l’histoire passionnante du cacao, jusqu’à la fabrication du chocolat, nous vous conseillons vivement le livre de Michel Barel : Du cacao au chocolat – L’épopée d’une gourmandise. (BAREL, Michel. Du cacao au chocolat : L’épopée d’une gourmandise. Editions Quæ, 2021.) Une lecture très instructive, accessible et captivante !

Crédits photo : Elle Inlom
Les défis du cacaoyer : maladies, monoculture et menace des OGM
Le cacaoyer est un arbre relativement fragile à cultiver. S’épanouissant dans des endroits chauds et humides, il ne supporte pas les rayons directs du soleil. Sa culture est donc restreinte à la zone dite « ceinture cacaoyère », située autour de l’équateur.
Il est sujet aux maladies, provoquées principalement par des champignons microscopiques. Les trois grandes maladies qui affectent les cacaoyers sont :
- la pourriture brune des cabosses, qui attaque les fruits et rend les fèves impropres à la consommation
- le balai des sorcières, qui affaiblit l’arbre jusqu’à le faire mourir d’épuisement
- la moniliose, qui détruit également les fèves à l’intérieur des cabosses (2).
D’ailleurs, une année, la moniliose a fait perdre 90% de la récolte de notre producteur Chema Pascacio, qui nous fournit les fèves de la variété Porcelana blanca, précieuse et fragile, pour la tablette de chocolat Mexique La Rioja 70%. Il a réussi à sauver une partie de sa récolte en protégeant chaque cabosse avec un sac plastique. Une opération de sauvetage laborieuse, mais nécessaire.
Les civilisations précolombiennes le savaient, les scientifiques le confirment aujourd’hui : le meilleur mode de culture pour un cacaoyer est l’agroforesterie. Entouré d’arbres plus hauts, il profite de l’ombrage créé par leur feuillage et des nutriments qu’ils restituent au sol. Ce mode de culture rend le cacaoyer moins vulnérable aux intempéries et aux maladies.
Mais aujourd’hui, la majorité des cacaoyers sont cultivés en monoculture, sous la chaleur écrasante du soleil, notamment en Côte d’Ivoire et au Ghana. Cette monoculture entraîne la déforestation des forêts vierges, ce qui accélère le réchauffement climatique. Celui-ci, à son tour, favorise l’apparition des maladies et des conditions météorologiques extrêmes : longues périodes de sécheresse suivies de pluies beaucoup trop abondantes. Les cacaoyers se retrouvent alors fortement fragilisés, et leur récolte sacrifiée. Ainsi, de nouvelles parcelles de forêt sont défrichées pour planter d’autres cacaoyers, et le cercle infernal continue.
Face aux défis climatiques et aux pénuries de cacao de plus en plus fréquentes, les industriels préfèrent contourner le problème plutôt que d’en traiter la cause. L’un des géants de l’agroalimentaire a ainsi entamé des recherches pour produire du cacao génétiquement modifié. L’idée ? Modifier le patrimoine génétique des cacaoyers pour créer des variétés plus résistantes aux maladies et aux conditions climatiques extrêmes, tout en conservant les qualités aromatiques du cacao.
Le seul problème : il s’avère que ce n’est pas si simple. Modifier le patrimoine génétique du cacao ne se fait pas aussi facilement que pour d’autres cultures comme le blé. Le cacao est un arbre complexe, intimement lié à son environnement, à la diversité de ses variétés et à l’écosystème qui l’entoure. Heureusement, le cacao OGM n’est pas près de voir le jour dans un futur proche. Mais en attendant, l’agriculture intensive continue d’appauvrir les sols, de réduire la biodiversité et de menacer les variétés traditionnelles..
Alors, quelle alternative pour affronter les défis de demain ? Revenir à la notion de respect envers la nature, toujours ancrée chez les peuples autochtones, descendants des civilisations précolombiennes. C’est ce qui nous a poussé à créer La Baleine à Cabosse : fabriquer du chocolat bean-to-bar, vertueux et respectueux de la planète, et contribuer, à notre petite échelle, au changement de la filière du cacao.
Sources:
(1) D’où vient le cacao ? Muséum national d’Histoire naturelle.
(2) BAREL Michel. Du cacao au chocolat : L’épopée d’une gourmandise. Editions Quæ. 2021.
(3) Motamayor JC, Lachenaud P, da Silva E Mota JW, Loor R, Kuhn DN, Brown JS, Schnell RJ. Geographic and genetic population differentiation of the Amazonian chocolate tree (Theobroma cacao L). PLoS One. 2008 Oct 1.